Les maitres de la stratégie – de Sun Zi à Warden
- Auteur CV(H) Gérald BONNIER
- Publié dans Aussi reçu
- Permalink
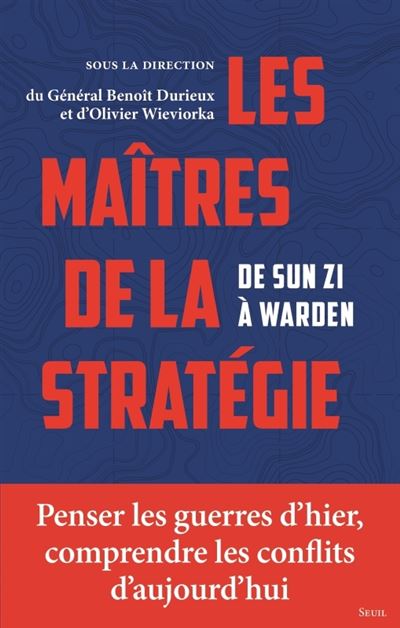
Cet ouvrage nous propose les biographies de 22 théoriciens de la stratégie militaire. Stratégistes et non pas stratèges car ils ont œuvré dans la pensée et non dans la pratique. Dans l’ensemble ils sont peu connus et parmi les grands généraux, rares sont ceux qui, comme le Maréchal Foch, ont théorisé leur action.
Mais d’abord qu’est-ce que la stratégie ? Pour certains c’est un art, basé sur l’instinct et le génie car il est impossible de répéter une expérience, pour d’autres c’est une science, puisqu’elle répond à quelques principes immuables. La stratégie est « une combinaison, d’actions militaires et non militaires pour atteindre un objectif politique, avec des ressources limitées, dans un contexte de compétition ou de conflit ». Elle se distingue de la tactique qui, sur le terrain, conduit et exécute les engagements dans le cadre défini par la stratégie. L’histoire a prouvé que perdre une bataille n’est pas perdre la guerre et que gagner des batailles sans buts politiques clairs, ne permet pas de gagner la guerre.
Les auteurs de ces 22 biographies d’une vingtaine de pages chacune, ont suivi le même schéma : après avoir rappelé les grandes étapes de la vie du personnage, ils exposent les grandes thèses qu’il a défendues et mesurent l’impact qu’elles ont eu.
Qui sont ces 22 stratégistes ? On connait certains noms comme Sun Zi, Machiavel, Carl von Clausewitz, Guibert, Jomini, Ferdinand Foch, ou les marins comme Alfred Thayer Mahan, Raoul Castex, sans toujours connaitre les idées force de leur œuvre.
Tous ont mené leur réflexion à partir des événements de leur époque et l’histoire est omniprésente dans ce livre. On en retiendra deux exemples particulièrement significatifs : Alexandre Sviétchine et Ferdinand Foch.
Alexandre Sviétchine (1878 – 1938), général russe passé du service du Tsar à celui de l’Armée Rouge, devient professeur à l’Académie militaire Frounzé. Il sera victime des grandes purges de Staline et exécuté. Depuis la fin de la guerre civile, les soviétiques ont le sentiment que l’URSS est une forteresse assiégée, menacée par les forces « impérialistes » françaises et anglaises. En 1926, la panique s’empare des dirigeants, de Staline à Vorochilov – commissaire du peuple à la défense, lorsque le maréchal Pilsudski revient au pouvoir en Pologne. Après avoir tenté d’unir la Pologne, l’Ukraine, la Biélorussie et les pays Baltes, il commandait les armées polonaises et ukrainiennes qui battirent en 1920 l’armée Rouge devant Varsovie. La Pologne et la Roumanie sont alors soupçonnées d’être les instruments des impérialistes et de préparer une guerre d’agression contre l’Union Soviétique. Lorsque les relations diplomatiques sont rompues entre l’Angleterre et l’URSS l’année suivante, pour eux, c’est certain, la guerre est imminente et l’Armée Rouge n’est pas prête. Sviétchine propose une stratégie d’usure, le temps de mobiliser les hommes puis de réarmer, avant d’éliminer la Roumanie et ensuite la Pologne. Stratégie qui ne sera pas retenue.
Ferdinand Foch (1851 – 1929), élève puis professeur à l’Ecole Supérieure de Guerre, où il se forma à l’étude critique des conflits passés, selon l’école qui vise à en dégager les principes pérennes de la guerre. Il étudiera en particulier les concepts qui, en 1870, avaient permis la victoire des Prussiens. Les trois principes énoncés par Foch : économie des forces, liberté d’action, sûreté d’action (agir en connaissance de cause), ont été sévèrement critiqués. Même Raymond Aron brocardait « la sottise infatuée » de Foch.
Avec un « pareil imbécile à leur tête, comment les armées alliées ont-elles pu l’emporter » en 1918 ?
Foch n’entendait pas « développer une théorie générale de la guerre, mais former les officiers français au conflit qu’ils pouvaient être amenés à conduire ». Il ne s’agissait pas de les « lester d’un catalogue de manœuvres prêtes à l’emploi », mais de « les faire travailler sur un maximum de cas concrets, qui sédimentés dans leur mémoire, les aideraient à s’orienter intuitivement ». Sur le plan tactique, Foch n’évoque dans ses écrits ni la mitrailleuse, ni l’automobile, ni l’avion dont l’emploi en était à leurs premiers balbutiements et il accorde une place disproportionnée aux forces morales. C’est le point faible sur lequel il a été attaqué. Mais il inspira Eisenhower, Patton, De Gaulle, De Lattre et aussi Clémenceau et Churchill.
Cet ouvrage donne les clés qui permettent de décrypter les politiques menées et les stratégies choisies par les puissances engagées dans les conflits actuels, de l’Ukraine au Moyen Orient. Très bien structuré, il permet, malgré le nombre de contributeurs, de comparer les analyses des stratégistes étudiés et de former sa propre culture de la stratégie militaire.
CV(H) Gérald BONNIER
03/04/2025
Les maitres de la stratégie – de Sun Zi à Warden
Sous la direction du Général Benoit Durieux et d’Olivier Wieviorka
Editions du Seuil Février 2025

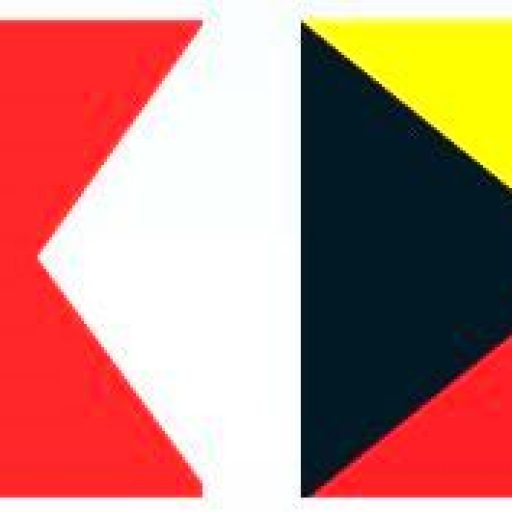 Les dernières recensions
Les dernières recensions